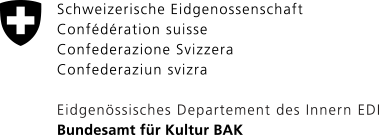30 April 2016

Anna Heck (1991) est née à Lausanne en Suisse. En 2015, elle reçoit son Bachelor en Design Industriel avec mention excellent à l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne. La même année, elle déménage à Rotterdam pour faire un stage dans le studio de design néerlandais Chris Kabel. Durant l’été 2014, elle part au Japon pour y faire un stage en design industriel chez Metaphys – un studio basé à Osaka – afin d’y découvrir la culture japonaise. Durant l’été 2015, elle participe au projet CHIC en collaboration avec l’Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL) ainsi que HEC et part durant un mois en Chine afin d’y produire un prototype pour une tablette connectée pour personnes âgées. Parallèlement, elle travaille sur des projets de scénographie, notamment pour l’exposition “L’éloge de l’heure” au Musée de design suisse (Mudac). Elle travaille également en tant que journaliste freelance pour les magasines d’architecture et de design suisse Maisons & Ambiances et My Room. En 2014, elle reçoit le prix suisse de la Fondation Barrière en tant que meilleure étudiant(e) en Bachelor à l’Ecal. Elle a également présenté un projet à l’exposition “Delirious Home” présentée au Salon de Milan en 2014 et qui s’est vue récompensée par le prix “Meilleures expositions du Salon du Meuble de Milan 2014”.

De quelle manière la notion d’UTOPIE est elle présente dans votre pratique, approche et/ou stratégie artistique?
« Utopie », selon Thomas More, signifie « nulle part » : un lieu qui n’est dans aucun lieu ; une présence absente, une réalité irréelle, un ailleurs nostalgique, une altérité sans identification. Autant de notions paradoxales qui nous amènent à réfléchir à ce qui existe effectivement. Dans ce sens, j’aime imaginer un ailleurs, un “autre part” meilleur, comme une sorte de provocation à la quotidienneté et à la dureté du réel. Plus loin, concevoir et croire à ce qui ne peut exister est pour moi une manière de poser des questions et de redéfinir ce qui est prédéfini, voire imposé, d’une façon subtile.
L’Utopie se comprend parfois comme la construction mentale d’un système ou d’un modèle idéal de société civile. Comment perçois-tu le rôle de la pratique créative dans ce contexte? Ou, dit d’une autre manière, penses-tu que le design peut changer la société?
L’ambivalence du rôle du designer dans la société se manifeste à travers la définition même de son mot. Au croisement de la forme et du projet, le design -du dessin à dessein – apparaît au centre du lieu privilégié de ce qui fait débat voire conflit. Le designer, à la fois observateur et acteur, est confronté à un constant dilemme: comment se positionner en décalage à la production industrielle tout en s’y inscrivant. C’est dans ce geste de questionnement, de renouvellement et de redéfinition constante que je comprends le design comme un agent important capable de provoquer des changements sociaux. Dans ce sens, le designer peut aider à améliorer la société, que ce soit à travers un geste formateur ou déformateur, à travers un travail d’amélioration ou d’interrogations.
Où puises-tu ton inspiration? Ton travail et/ou ton état d’esprit sont-ils guidés par des références particulières?

Le travail de l’artiste et metteur en scène américain Robert Wilson me fascine en particulier. Sa démarche, presque maniaque, à travers laquelle il dissèque et découpe le geste, la parole, le texte, l’image afin de créer une nouvelle composition, un collage original, m’intéresse profondément. La forme abstraite de son sens apparaît comme la base d’un nouveau langage mystérieux, sensible, atmosphérique. C’est cet aspect de l’objet qui m’intéresse: son aura, les formes invisibles qu’il recèle, son histoire. Dans cette même optique, je trouve une certaine inspiration dans le travail du designer japonais Tokujin Yoshioka qui tente de recréer des ambiances à travers des objets, sculptures, installations d’une “seconde nature”. Plus loin et dans une perspective d’introspection et de réflexion sur l’objet, la vidéoconférence de l’artiste Amalia Ulman “Buyer, Walker, Rover” m’a profondément interpellée pour la pertinence de son analyse sur les objets, leur contexte, les interactions qu’ils entretiennent avec leur environnement ainsi que les systèmes auxquels ils participent.
Plus sur Anna Heck ici.